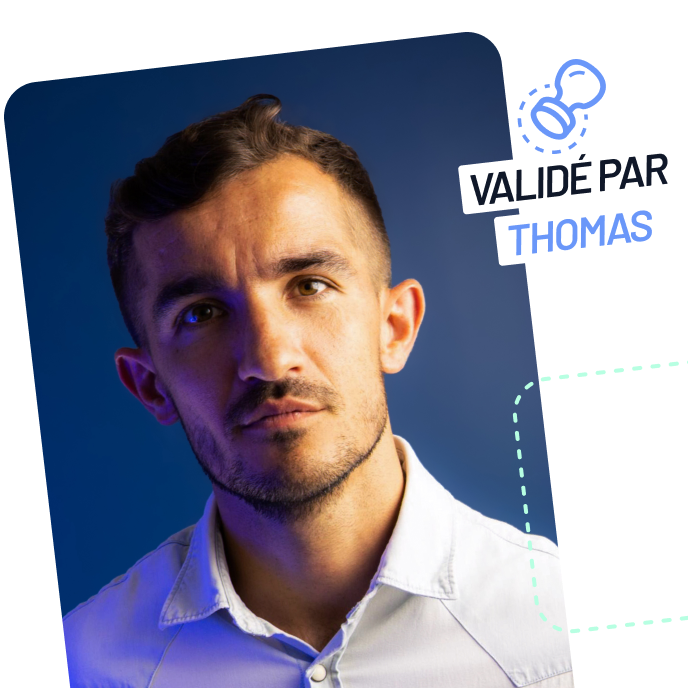« Ce n’est pas une science exacte » : les secrets d’une collaboration réussie entre marques et créateurs
Comment déterminer le « juste prix » d’un partenariat ? Quelles sont les clés d’une collaboration réussie entre marques et créateurs ? Nawal Stouli, fondatrice de l’agence Loopin (Cyrus North, Scilabus), a répondu à ces questions pour BDM.

Dans le cadre des opérations commerciales, est-ce généralement les marques qui approchent les agents avec un profil précis en tête, ou les créateurs et créatrices qui prennent l’initiative en ciblant les marques avec lesquelles ils souhaitent collaborer ?
Les deux. C’est compliqué de donner un pourcentage, parce que c’est difficile à tracer précisément, mais je dirais qu’on tourne autour d’un 50-50. Mais ça a beaucoup évolué ces dernières années. Avant, on gérait plus de demandes émanant des marques. Mais souvent, en fin d’année, on constatait que les créateurs ou créatrices n’avaient pas pu bosser sur leurs projets à eux, parce qu’on passait notre temps à répondre et à se réapproprier des briefs. Maintenant, on essaie de rééquilibrer ce rapport-là.
Notre travail consiste, bien sûr, à gérer les demandes entrantes, mais aussi à aller chercher des partenaires qui collent à leurs envies et qu’ils apprécient. Mon client, c’est le créateur ou la créatrice. Quand on accueille quelqu’un dans l’agence, je lui demande toujours : « C’est quoi tes marques de rêves ? Celles que tu utilises, que tu aimes vraiment ? » L’idée, c’est de rester cohérent, de ne pas trahir la confiance de l’audience et ça suppose de ne pas faire n’importe quoi. Si le créateur ou la créatrice a un iPhone et porte un sac Eastpak, je ne vais pas proposer une collaboration commerciale avec Huawei ou Cabaia.
Je fais pas mal de démarchages, et ça marche de mieux en mieux, parce qu’on récolte le fruit de plusieurs années de travail. L’objectif, à terme, c’est que les idées viennent surtout des créateurs et créatrices et qu’à côté, on puisse gérer des demandes de marques qui arrivent avec des projets déjà très aboutis, où il n’y a quasiment rien à retoucher.
Menez-vous un travail de veille sur les marques pour anticiper d’éventuelles polémiques ? Comment évaluez-vous la réputation d’un annonceur avant d’envisager une collaboration ?
Oui. L’agence accompagne des créateurs et créatrices dans plein de secteurs : la tech, la santé, la langue française, les maths, l’histoire… C’est impossible d’avoir une expertise sur tous ces sujets.
Lorsqu’on reçoit une demande, la première chose à clarifier, c’est : qui est notre interlocuteur ? Si ce n’est pas un ministère, un musée, un centre de recherche ou une marque connue, on creuse. Qui finance ? Où est-elle basée ? A-t-elle une entité juridique ? Est-ce qu’ils ont déjà réalisé des collaborations commerciales, avec qui et pour faire passer quel message ?
Mon équipe est parfaitement formée à cette première étape de vérification, qu’on effectue systématiquement dès qu’on ne connaît pas la marque. On consulte les avis, on s’assure qu’aucun scandale n’a éclaté par le passé et on effectue également des vérifications en situation de client mystère. Et ça, les marques ne le savent pas toujours. Lorsqu’une marque nous sollicite, son discours est toujours bien rodé et notre travail, c’est de trouver le problème s’il existe. Je dis souvent qu’on a un petit rôle de détective.
Puis, selon la complexité du sujet, on fait appel à des experts de notre réseau ou de celui du créateur ou de la créatrice. Au-delà de leur propre expertise, certains sont hyper connectés avec le milieu de la recherche et peuvent simplement passer un coup de fil pour vérifier une info.
Mais je suis très modeste sur ces sujets-là. J’ai mis en place une charte éthique, et tous les ans, on la relit avec mon équipe. Ça nous remet un cadre. J’ai des experts que j’appelle pour vérifier certaines choses, mais je dis toujours : on ne peut pas tout savoir. Le risque zéro n’existe pas.
Évidemment, il y a des cas où on dit non tout de suite. Par exemple, quand un acteur de l’industrie du tabac t’appelle en disant : « On veut communiquer sur le sevrage tabagique. » Là, tu souris, tu dis « non merci », et tu passes à autre chose.
Quels critères entrent en jeu pour définir le « juste prix » d’un contenu sponsorisé ?
Ce n’est pas une science exacte, il n’y a pas de formule mathématique. Sinon, ce serait trop simple. Mais il y a plusieurs critères.
D’abord, les chiffres : le nombre d’abonnés, et surtout le nombre de vues. Ensuite, la plateforme. Parce que 100 000 vues sur YouTube ou sur TikTok, ce n’est pas du tout la même chose. Sur YouTube, c’est environ dix fois plus cher, parce que c’est plus dur d’y faire des vues et qu’elles sont plus qualitatives.
Ensuite, le livrable : est-ce un contenu long ou court ? Est-ce que le créateur cède ses droits pour que la marque réutilise le contenu ? Est-ce qu’elle met de l’argent en plus pour de la médiatisation ? Est-ce que la créatrice ou le créateur doit se déplacer ou est-ce qu’il filme depuis son studio ? Là encore, les prix changent.
Je valorise aussi les diplômes. Certains de mes créateurs et créatrices ont des doctorats. Leur contenu est d’une qualité rare, et ça se paie.
À tout cela s’ajoute la nature du client. Une entreprise du CAC 40 ne sera pas facturée comme une jeune structure qu’on aime bien et qu’on a envie d’aider. Je leur dis clairement : si je facture plus cher à certains, c’est pour pouvoir travailler à prix réduit avec des ONG ou des associations.
Et puis, comme sur tout marché, il y a l’offre et la demande. Certains créateurs ou créatrices sont plus demandés que d’autres, donc mécaniquement, leur prix augmente. Deux profils avec le même nombre d’abonnés peuvent avoir jusqu’à 25 ou 30 % d’écart de tarif, et les marques le comprennent très bien : quand tu es le seul en France à parler d’un sujet, tu es rare, donc plus cher.
Enfin, il y a le volume global de production. J’ai des profils qui ne produisent que six vidéos par an — et qui n’ont donc que six emplacements possibles. À l’inverse, ceux qui publient chaque semaine ont plus de place pour des collaborations, donc les prix diminuent.
Les créateurs et créatrices interviennent seulement quand on sort de la grille tarifaire. Si la marque refuse un prix, qu’on doit ajuster, c’est à eux de décider.
À quel point les marques sont-elles interventionnistes ? Ont-elles un droit de regard sur le contenu ?
Elles sont plus formées, connaissent mieux le marché, savent ce qu’elles peuvent demander ou non. Elles sont plus exigeantes, aussi, parce qu’elles ont de l’expérience, elles ont testé des choses et savent ce qui fonctionne.
Elles ont le droit d’intervenir sur les intégrations, car on répond à un brief. Elles valident les scripts et peuvent demander une correction si le créateur s’est trompé sur un chiffre ou sur un élément. Mais il y a une limite : elles ne doivent pas parler à sa place. Réécrire son texte, c’est interdit. C’est là où l’agent est très utile, pour faire tampon avec la marque en disant : « Ça, c’est sa façon de parler, on ne touche pas. En revanche, là, vous avez raison, c’était une erreur, on corrige. »
C’est toujours un équilibre entre les intérêts de la marque et ceux du créateur ou de la créatrice. Et je trouve qu’aujourd’hui, les marques sont plus pertinentes. Parfois, elles ont des retours très utiles : « On a testé cette formulation quatre fois, les gens ne comprennent pas, vaut mieux dire autrement. »
Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’une collaboration entre un créateur ou créatrice et une marque est réussie, à la fois sur le fond et sur la forme ?
Il y a trois choses : du temps, de l’argent et du lâcher-prise.
Du temps, d’abord, pour travailler correctement. Souvent, les marques nous appellent au dernier moment, et on se retrouve à tout faire dans le rush. J’ai appris à dire non à ça. Je leur dis : « C’est super, mais dans trois semaines, ce ne sera pas possible. » Parce que le créateur n’a pas le temps de s’imprégner du brief et parce que ça chamboule potentiellement son planning.
Ensuite, de l’argent. Une bonne rémunération, c’est important pour bien travailler. Tout travail mérite salaire, et si le budget n’est pas là, le contenu sera forcément moins bon.
Et enfin, du lâcher-prise, des deux côtés. Côté marque, il faut comprendre qu’un créateur n’est pas un comédien. Il ne va pas recracher un brief ou une baseline marketing. Ce n’est pas son ton, ni son vocabulaire. Et côté créateur, il faut aussi accepter de jouer le jeu, d’assumer le fait que c’est une collaboration commerciale, et d’en faire quelque chose de fun.
Une collaboration réussie, c’est un alignement de planètes. C’est notre travail, en tant qu’agence, de trouver le bon sujet, la bonne marque, le bon créateur, et le bon timing pour créer cet alignement-là.

Nawal Stouli, Fondatrice
Experte de l’influence, Nawal Stouli cofonde Loopin en 2021, première agence dédiée aux créateurs et créatrices qui vulgarisent leur savoir sur internet. Membre du COMEX de l’UMICC, elle est également à l’origine de BetHer, un programme qui accompagne les créatrices dans leur professionnalisation. En 2025, elle publie C’est moi l’influenceur.se (Éditions Nathan, 2025), un guide de référence pour comprendre les nouveaux métiers de l’influence et de la creator economy.


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis