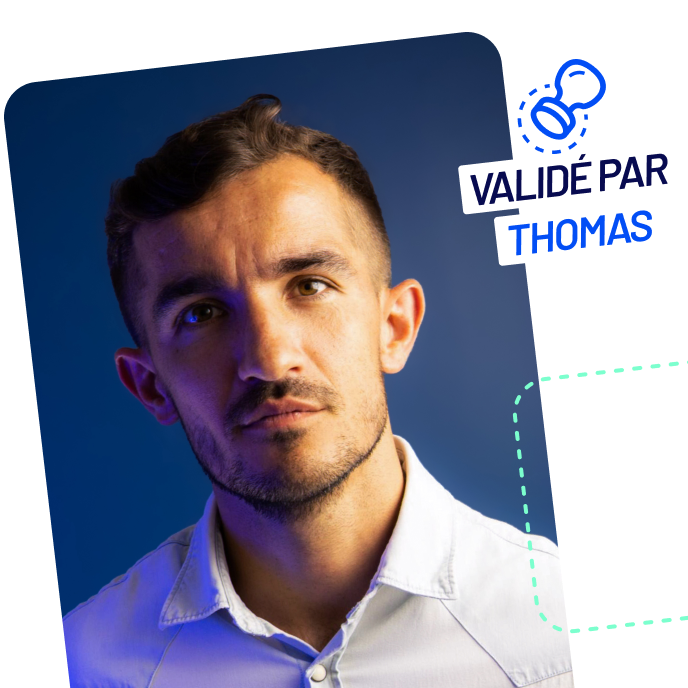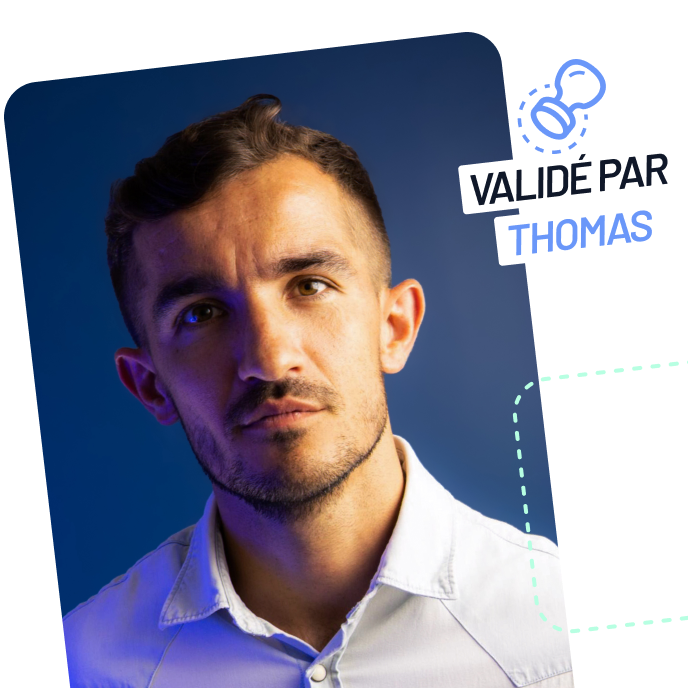Les stories, un format efficace et scalable pour les médias ?
A l’occasion des Rencontres francophones de la vidéo mobile organisées par Samsa, nous avons assisté à une table ronde sur l’usage des stories, de plus en plus utilisées pour communiquer notamment par les médias. Intitulé « Les stories, pour quoi faire ? Les stories, comment faire ? », l’échange était animé par Stéphane Saulnier, rédacteur en chef de FigStory pour Le Figaro, Charlotte Van Breusegem, étudiante en journalisme et David Botbol, directeur adjoint de la rédaction des Sports de France Télévisions.

Différentes façons de procéder pour une même finalité : raconter une histoire
Les intervenants de la conférence racontent tous leurs modes de fonctionnement respectifs, très différents. Le Figaro par exemple s’adresse à une audience identifiée et qualifiée, via des stories « in app », consommées par les utilisateurs de l’application du journal. Stéphane Saulnier décrit les différents formats proposés :
- Les stories dites classiques, élaborées par le service social media.
- Les stories éditorialisées, travaillées pour mêler image, son, vidéo ou animations.
- Le format « vous à moi » dans lequel la parole est donnée aux journalistes de la rédaction sur des sujets parfois complexes traités en amont.
Les différentes stories proposées dans une autre application qu’Instagram s’inspirent du réseau social, sans pour autant en reprendre tous les codes. Par exemple, sur l’application du Figaro, l’enchaînement des stories se fait ainsi par « swipe » et non par « tap ».
Chez France Télévisions, les contenus à publier sur les réseaux sociaux sont créés par une rédaction numérique, qui chaque matin discute des thématiques à mettre en avant dans la story quotidienne. Selon David Botbol, les sujets varient en fonction de l’actualité et des ressources à disposition. Les reporters et les personnes en général (influenceurs ou sportifs lors d’événements…) sont souvent mis à contribution pour générer une forme d’interactivité et de spontanéité, qui fait que le produit final peut parfois ne pas être au point techniquement mais apporte un côté « coulisses », avec des images que l’on ne voit pas à la télé. L’essentiel selon lui étant de jouer sur la spontanéité pour raconter une histoire. France TV s’appuie également sur les nombreuses ressources vidéo des différentes chaînes et émissions (Tout le sport, Stade 2…), pour enrichir ses stories et créer des passerelles entre Instagram et les programmes permettant ainsi d’engendrer du clic, des vues, pousser les directs ou les contenus des émissions en replay. David Botbol souligne que toutes les stories France TV sont également archivées, avec une fonctionnalité actuellement en développement qui permet de les répertorier et de les mettre à disposition des internautes qui fréquentent les supports traditionnels (site web + app), preuve du rôle prépondérant qu’à ce nouveau format pour les médias et leur souhait qu’elles soient vues par le plus grand nombre.
Charlotte Van Breusegem quant à elle utilise les stories Instagram à titre personnel. Elle consomme beaucoup de stories qui sortent du cadre du journalisme, fournies par des influenceuses pour la plupart. Elle tente d’utiliser ces codes et de les appliquer au journalisme, fascinée par l’interaction inédite développée par ces profils avec leur communauté. L’aspect créatif proposé par les stories est important selon elle grâce aux outils fournis par l’application (sondages, compte à rebours, stickers…) et ceux des applications connexes : « c’est le combo de l’interactivité et de l’esthétisme du contenu proposé qui permet aux journalistes de raconter une histoire qui sera suivie ».
Un format qui offre une multitude de possibilités et nécessite peu de moyens
Quand on les interroge sur la raison qui les a poussés à exploiter un tel format, les intervenants sont tous unanimes : les stories offrent de multiples possibilités et ne mobilisent pas de gros moyens, qu’ils soient financiers ou humains.
Au Figaro, les stories sont gérées par un service de 3 personnes, qui produisent en moyenne 100 à 120 stories par an. La création de ces contenus nécessite un travail de storytelling, avec une recherche de nouveaux formats et de nouvelles façons de raconter. Le service peut tout de même utiliser les studios du Figaro, ce qui permet d’avoir un rendu très qualitatif facilité par l’utilisation de plusieurs caméras, plusieurs plans… et laisse très peu de place à l’instantané, sauf lors de déplacements sur le terrain. En général une story publiée « in app » est ainsi réalisée en 2,3 jours, afin d’avoir un rendu bien travaillé. Sur Instagram les stories sont souvent les mêmes que sur l’application Le Figaro, mais pas toujours, avec des usages et des profils ciblés qui peuvent être différents. En effet, Stéphane Saulnier affirme que pour parler du mouvement des Gilets Jaunes par exemple, beaucoup de lives sur le sujet ont été faits sur le réseau social dans le but de conquérir une cible plus jeune qui peut s’avérer intéressante pour le journal.
Pour David Botbol, le fait de se mettre à créer des stories répond à une volonté évidente de France TV d’être présent sur tous les supports possibles, et ainsi de générer de l’audience sur des supports non traditionnels grâce à un usage qui s’est généralisé, un type d’écriture que l’on retrouve aussi sur les autres réseaux sociaux. Selon lui, les journalistes ont évolué au fil du temps et acquis des compétences qui vont rester et seront recyclées ailleurs. Avant d’utiliser Instagram, les journalistes de France TV ont par exemple utilisé Discover sur Snapchat. La production de ces contenus au sein du groupe se fait de façon individuelle avec peu de moyens, un appui technique et un motion designer qui génère des templates, afin que les journalistes puissent être autonomes dans la création de sujets. Le processus de rédaction fait aussi parfois appel à des journalistes TV, qui sont également entraînés dans ce processus de création de stories et prennent même parfois la main.
De son côté, Charlotte Van Breusegem utilise son profil Instagram comme un laboratoire, afin d’expérimenter différents types de stories dans sa quête de les adapter au journalisme. Selon elle, les stories offrent un process multiple et infini selon ce qu’on décide de faire. Elle souhaite de son côté varier les choses, avec des codes complètement différents selon les reportages (par les outils utilisés, l’esthétisme etc). Récemment, elle a recyclé un web documentaire réalisé précédemment pour le convertir en story Insta. Cette expérimentation lui a ainsi montré qu’il est possible de réutiliser et lier des sources différentes (photo, vidéo, audio) pour les poster sur Instagram et les transformer en story. Elle poursuit en affirmant que le principe du taping pour passer d’une slide a une autre est quelque chose de révolutionnaire, adapté à notre consommation actuelle : « Nous sommes acteurs de ce que l’on veut regarder, on décide. Le temps de lecture est réadapté et le récepteur est ainsi à la fois maître et acteur de la story qu’il consomme ».


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis