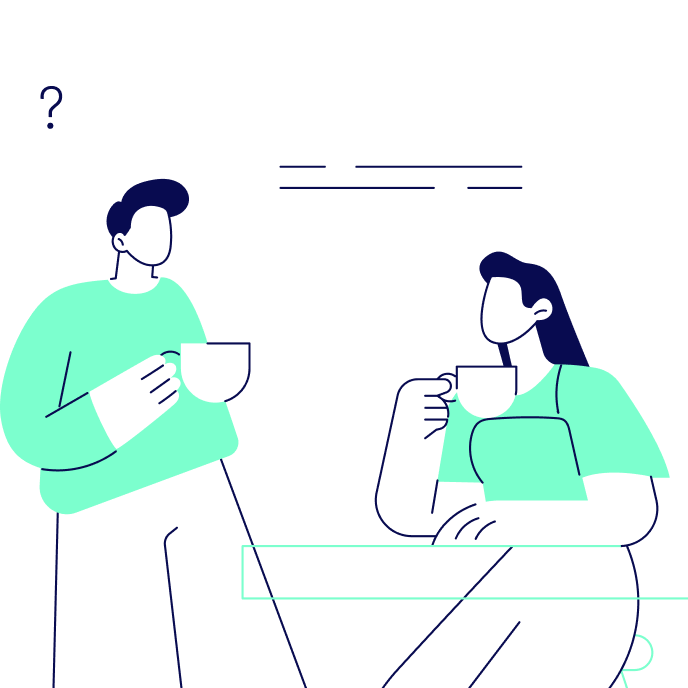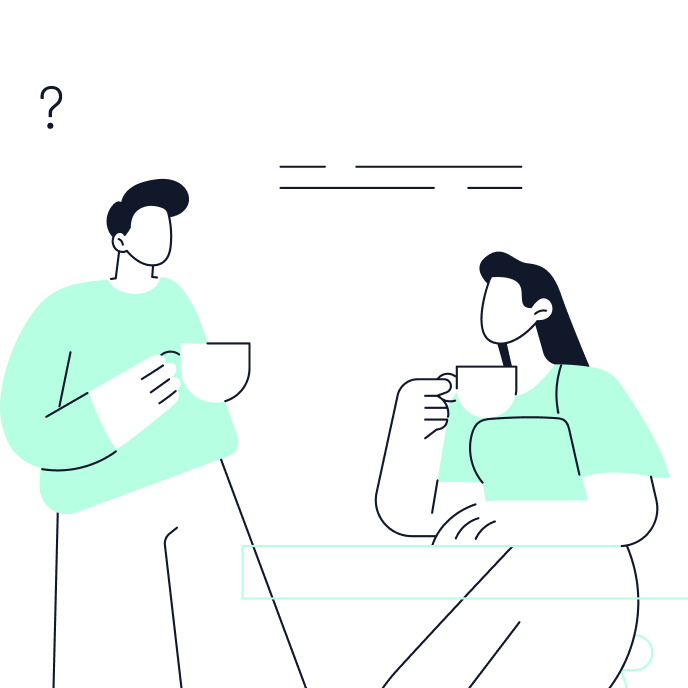« Mener la chasse à tout prix aux faux avis n’est pas dans l’intérêt des plateformes »
Une enquête de l’UFC-Que Choisir met en doute la fiabilité des témoignages qui foisonnent sur le web et auxquels les consommateurs accordent instinctivement du crédit. BDM a échangé avec Cyril Brosset, coauteur de cette enquête.

Faut-il se fier aux témoignages laissés par les consommateurs sur Google, Tripadvisor ou Darty pour choisir un restaurant, un coiffeur ou trouver son prochain aspirateur ? C’est l’épineuse question à laquelle a tenté de répondre l’UFC-Que Choisir dans une enquête publiée ce jeudi 20 février 2025.
Pour comprendre comment ses lecteurs utilisent les avis en ligne, mais aussi analyser la manière dont ils contribuaient à leur création, l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir leur a diffusé un questionnaire, tout en menant ses propres expérimentations en parallèle. Et les conclusions sont claires : « Notre enquête montre à quel point il est facile de manipuler [les avis] », écrit Cyril Brosset, journaliste à l’UFC-Que Choisir et coauteur de l’enquête. Et ce, bien que la publication d’un avis frauduleux soit considérée comme une pratique commerciale trompeuse. Et, à ce titre, pénalement répréhensible.
Lors d’un entretien accordé à BDM, il revient sur les découvertes de l’Observatoire de la consommation. Entre stratégies bien rodées, pratiques illégales et système de modération loin d’être infaillible.
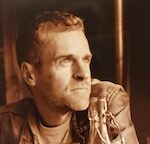
Cyril Brosset, journaliste à l'UFC-Que Choisir
Diplômé de l’ESJ Paris, Cyril Brosset est journaliste à l’UFC-Que Choisir depuis 2004. Spécialiste des télécoms et du commerce en ligne, il pilote la rubrique Nouvelles technologies du magazine.
Quelles sont les stratégies les plus couramment utilisées pour contourner aussi bien les algorithmes que la modération de ces plateformes ?
Les techniques sont très variées et concernent toutes les plateformes, y compris celles qui proposent des avis vérifiés. Cela peut aller du petit restaurateur qui publie lui-même des avis positifs sur son établissement – une pratique que nous avons pu constater à plusieurs reprises – à des bars ou restaurants qui offrent un cadeau, un verre ou un dessert en échange d’un avis positif sur Google. C’est une pratique assez courante.
Parfois, ça va encore plus loin : certains professionnels achètent de faux avis ou demandent à leurs employés d’en publier. Et lorsque les plateformes renforcent leurs contrôles, par exemple en exigeant un achat ou une réservation pour laisser un avis, on constate que certains professionnels peuvent proposer des cadeaux ou des bons de réduction sur un prochain achat, en échange d’un bon avis. Voire carrément rembourser le produit en échange d’un avis 5 étoiles. Et on s’aperçoit que toutes les plateformes sont concernées par ces pratiques.
L’autre approche consiste à trier les avis. Certains jouent le jeu, répondent aux consommateurs, mais d’autres n’hésitent pas à supprimer les avis qui leur déplaisent. Notamment sur leur propre site ou sur leur page Facebook. Tous ces facteurs font que de nombreux avis ne reflètent pas forcément la réalité.
La pratique consistant à offrir une contrepartie en échange d’un avis est-elle tolérée ?
La pratique est interdite, et les plateformes affirment lutter contre cela. Mais de nombreux marchands indépendants, qui utilisent ces services, parviennent à contourner les systèmes de contrôle. Et dans un sens, il est vrai que détecter ces fraudes n’est pas toujours simple. Mais très clairement, certains professionnels proposent des bons d’achat en échange d’avis positifs, et les plateformes ont du mal à le contrôler. Lorsqu’elles sont alertées, elles ne prennent pas toujours les mesures qui s’imposent, parce qu’il faut maintenir un équilibre : elles ont besoin de ces avis pour que les consommateurs aient confiance, tout en s’assurant que les contrôles ne leur coûtent pas trop cher. Et il faut aussi éviter de contrarier les professionnels, pour qu’ils continuent d’intervenir sur leurs plateformes.
La modération sur ces plateformes est souvent jugée opaque. Dispose-t-on d’informations sur les critères utilisés par les modérateurs pour filtrer les avis ?
Non. Si l’on en croit les plateformes, elles ont des algorithmes censés vérifier chaque avis en fonction de nombreux critères, comme le lieu depuis lequel il a été posté ou le profil de son auteur. En cas de doute, l’avis est transmis à une équipe de modérateurs, en chair et en os, qui décide de le valider ou non.
Dans la réalité, on constate que c’est plus compliqué. Certaines plateformes, que nous avons testées, publient systématiquement les avis. S’il existait un véritable filtrage, les avis que nous avons postés sur Tripadvisor auraient été identifiés comme frauduleux. Or, ils ont été publiés, alors qu’ils avaient été rédigés depuis le même compte, au même moment, pour des établissements où nous n’étions jamais allés – parfois même dans des pays que nous n’avions jamais visités. Dans certains cas, les établissements n’existaient même pas.
Sur certaines plateformes, notamment Facebook, les avis étaient davantage contrôlés : certaines de nos publications n’ont jamais été validées. D’ailleurs, plusieurs services communiquent sur leur taux de refus. Certains affirment d’ailleurs rejeter environ 10 % des avis soumis. Mais en creusant, on constate qu’ils ne sont pas refusés car ils sont frauduleux, mais parce qu’ils contiennent un discours jugé dénigrant ou commercial. Parfois, on ne sait pas pourquoi ils sont refusés : plusieurs répondants nous ont dit que leur avis n’avait pas été publié alors qu’il n’avait rien de dénigrant. Souvent, le problème était qu’il était simplement négatif.
Les plateformes se basent aussi beaucoup sur les signalements. L’avis est d’abord publié, puis vérifié seulement s’il est signalé. C’est présenté comme de la modération, alors que l’avis était bien visible à un moment donné. Et même dans ces cas-là, les critères de suppression restent flous : certaines publications disparaissent, d’autres non.
Les plateformes sont-elles tenues de justifier leur refus aux utilisateurs ?
En principe, lorsqu’un avis est refusé, la plateforme doit justifier son refus. Mais, dans la majorité des cas, elle se contente d’indiquer que l’avis n’est pas en accord avec sa politique de publication, sans plus de précisions. C’est très vague, et ça l’est tout autant pour la suppression, quand un avis dénigrant est signalé par un professionnel. Dans ces cas-là, ils essayent de multiplier les preuves, pour avoir plus de chance qu’il soit retiré.
Certaines plateformes sont-elles plus fiables en matière d’avis ?
Sur les « plateformes fermées », il faut avoir acheté un produit ou réservé un service pour pouvoir laisser un avis. Cela réduit globalement le nombre de faux avis, même si, on l’a vu, certains professionnels parviennent malgré tout à contourner les règles. Mais elles comptent aussi moins d’avis, et il est donc difficile de savoir si elles sont réellement plus fiables. À l’inverse, sur les « plateformes ouvertes », il y a certainement plus d’avis frauduleux, mais qui se retrouvent noyés dans la masse. Je ne dirais pas que les plateformes fermées sont forcément plus fiables. Tout dépend de la manière dont chaque service gère ses avis et applique sa modération.
Dans votre enquête, vous précisez que la DGCCRF a créé son propre outil pour identifier les faux avis, nommé Polygraphe. Pourquoi, selon vous, n’existe-t-il pas un équivalent pour les consommateurs ?
J’ai testé certains outils censés évaluer la véracité des avis, mais les résultats ne m’ont pas paru convaincants, et c’est pour cette raison que je n’en ai pas parlé dans l’enquête. Il faut admettre qu’il est assez compliqué de détecter un faux avis, et il assez peu probable qu’un outil soit fiable à 100 % sur ce sujet.
Quels sont les principaux signes qui peuvent permettre au consommateur de débusquer un faux avis ?
Pour se forger une opinion sur un produit ou un service à partir des avis en ligne, ça semble assez évident, mais il faut en consulter une dizaine, une vingtaine, en variant les sources. Lire des avis anciens, récents, positifs comme négatifs, et surtout ne pas se limiter à une seule plateforme. Il ne faut surtout pas se fier à un ou deux avis, surtout s’ils sont très récents ou publiés par des comptes créés pour l’occasion.
Certains signes sont assez reconnaissables, aussi, comme l’utilisation d’un vocabulaire dithyrambique ou des détails qui sortent de l’ordinaire. J’ai déjà lu des avis qui énuméraient tous les serveurs d’un restaurant par leur prénom, par exemple. Ça peut paraître gros, mais ça existe.
Dans la mesure où il s’agit d’un enjeu à la fois pour les consommateurs et les commerçants, faudrait-il confier la régulation des avis en ligne à une autorité indépendante, même si la DGCCRF effectue déjà des contrôles ?
C’est le rôle de la DGCCRF de veiller à ce que le commerce se déroule dans des conditions équitables et que le consommateur ne soit pas trompé. Mais très clairement, leurs ressources sont limitées. Dans l’idéal, il faudrait renforcer les effectifs, voire créer une autorité dédiée pour lutter contre ce phénomène. Mais à mon avis, ce n’est pas demain la veille.
Les plateformes ont tout intérêt à accumuler un maximum d’avis. Il n’est pas dans leur intérêt d’en supprimer trop.
Peut-on estimer qu’il n’est pas vraiment dans l’intérêt des plateformes d’éradiquer totalement les faux avis ?
Les plateformes ont tout intérêt à accumuler un maximum d’avis. Il n’est pas dans leur intérêt d’en supprimer trop. Tant que cela ne remet pas en cause la confiance du consommateur, elles peuvent se dire qu’en laisser passer quelques-uns, ce n’est pas très grave. Elles savent parfaitement que ça existe, mais leur priorité est d’assurer un équilibre : limiter les coûts, tout en satisfaisant les consommateurs et en gardant les professionnels engagés sur leur plateforme. Mener la chasse à tout prix aux faux avis n’est pas dans leur intérêt.


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis