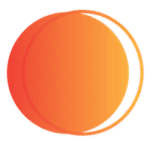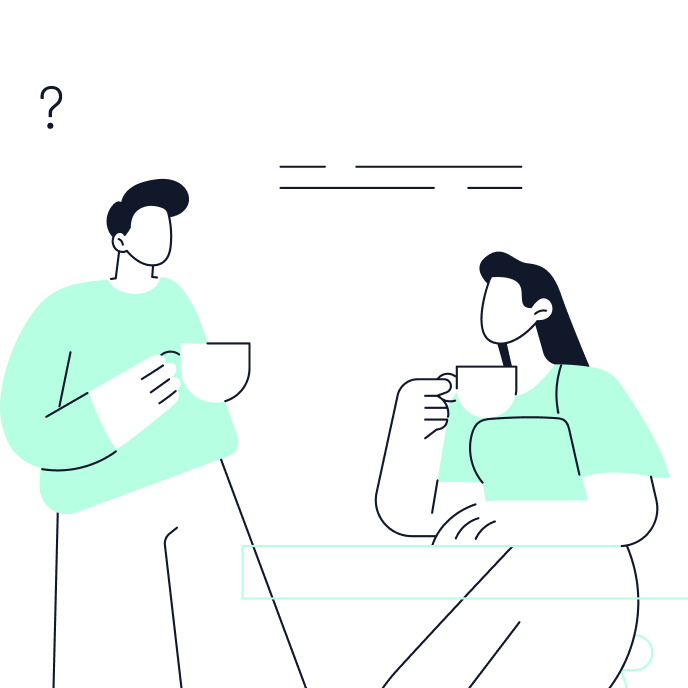Je suis mort : que devient mon identité numérique ?
La mort n’efface pas nos traces en ligne. Profils, messages et données continuent d’exister. La CNIL détaille les droits permettant d’anticiper ou d’agir après un décès.

Nos vies numériques s’étendent bien au-delà de notre existence. Réseaux sociaux, messageries, comptes en ligne et traces diverses continuent de subsister sur Internent lorsque leur titulaire disparaît. Comme l’explique la CNIL, cette situation concerne déjà un grand nombre de personnes, et les plateformes sont chaque jour confrontées aux comptes de millions d’utilisateurs décédés. Que deviennent ces données et quels sont les droits de chacun face à cette présence numérique post mortem ?
Ce que devient un compte numérique après un décès
Lorsqu’un utilisateur décède, ses comptes ne sont pas automatiquement fermés ou transformés. Comme le précise la CNIL, un profil inactif n’est pas identifiable comme appartenant à une personne décédée, ce qui conduit les plateformes à laisser ces comptes en ligne tant qu’aucune instruction ou demande n’est formulée. Cette situation contribue à l’accumulation de profils de personnes disparues, un phénomène déjà visible. Une enquête menée pour la CNIL en 2024 indiquait qu’un tiers des Français avait déjà été confronté à des contenus provenant de comptes de personnes décédées.
Faute de règles automatiques, la gestion repose sur les politiques internes des services. La CNIL rappelle qu’il est recommandé aux plateformes de supprimer les comptes après une longue période d’inactivité, éventuellement après avoir envoyé un avertissement. En l’absence de telles mesures, et sans intervention de proches ou d’héritiers, les traces numériques du défunt peuvent rester visibles indéfiniment. Une présence post mortem qui peut interroger ou perturber.
Ce que chacun peut prévoir de son vivant
La législation française permet à toute personne d’indiquer, de son vivant, ce qu’elle souhaite pour ses données après son décès. Comme le rappelle la CNIL, ces instructions peuvent prendre deux formes. Les directives générales, comparables à un testament numérique, sont enregistrées auprès d’un tiers de confiance (un notaire, par exemple) et couvrent l’ensemble des données personnelles du défunt. Les directives particulières, elles, visent un service précis et doivent être transmises directement à la plateforme concernée. Dans les deux cas, la personne peut les modifier ou les retirer à tout moment. De son vivant, bien sûr…
Au-delà de ce cadre légal, plusieurs services numériques proposent leurs propres outils pour anticiper le devenir d’un compte. La CNIL cite notamment la possibilité de désigner un contact légataire, de demander la transformation d’un profil en compte commémoratif ou d’opter pour la suppression automatique après une période d’inactivité. Ces mécanismes permettent d’organiser son héritage numérique de manière concrète, en précisant ses souhaits au plus près des usages. Sur Facebook, par exemple, il est possible de programmer la suppression d’un compte ou d’ajouter des contacts légataire. Après un décès, il est possible de demander la suppression, la restriction de l’accès à certaines données, ou la transformation du profil en compte commémoratif.
La liste des paramétrages disponibles pour chaque plateforme
Les droits des proches lorsqu’aucune directive n’existe
Lorsque la personne décédée n’a laissé aucune instruction, le cadre prévu par la loi Informatique et Libertés s’applique. Comme le souligne la CNIL, les comptes et messages restent protégés par le secret des correspondances : ils demeurent strictement personnels et ne deviennent pas librement accessibles. Les proches et héritiers disposent toutefois de droits limités, liés à la succession. Ils peuvent demander la clôture des comptes du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données le concernant, ou obtenir les informations nécessaires à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi accéder à certains biens numériques ou éléments assimilés à des souvenirs familiaux, lorsque ceux-ci sont transmissibles.
Pour activer ces démarches, il leur revient de signaler le décès à chaque service utilisé par le défunt. Comme le précise la CNIL, les plateformes doivent alors vérifier la réalité du décès et peuvent demander des justificatifs tels qu’un certificat, une pièce d’identité ou un document nécrologique. Ce signalement constitue le point d’entrée permettant aux proches d’exercer leurs droits et d’éviter que les données du disparu continuent d’être traitées sans prendre en compte son absence.
Les cas particuliers et les recours
Certaines données obéissent à des règles spécifiques après un décès. La CNIL rappelle que l’accès aux informations de santé d’une personne décédée est possible lorsque cela est nécessaire à l’organisation ou au règlement de la succession. Ces données peuvent aussi être utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, sauf opposition écrite exprimée du vivant de l’intéressé(e). La loi prévoit également la communication d’informations lorsque cela est indispensable pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou permettre à ses proches de faire valoir leurs droits.
En cas de difficulté ou d’atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la mémoire du défunt, les proches disposent de recours judiciaires. La CNIL explique qu’ils peuvent saisir les tribunaux pour obtenir réparation lorsqu’un traitement de données cause un préjudice ou maintient en ligne des éléments portant atteinte au défunt. Ces actions offrent un cadre juridique permettant de faire respecter les volontés exprimées ou de protéger la dignité de la personne après sa mort.


La boîte à questions sur l'IA générative
Outils, prompts, usages professionnels, comparatifs... Posez toutes vos questions à Ludovic Salenne, expert IA !
Je pose une question