Comment Le Télégramme a adapté sa ligne éditoriale à sa stratégie de contenus payants
Samuel Petit, rédacteur en chef du Télégramme, nous explique comment le journal a adapté sa manière de produire des contenus suite à la mise en place d’un paywall sur ses articles en ligne.

Le digital a changé la manière dont les médias abordent la question de leur monétisation. Certains optent pour un modèle gratuit engendrant une course à l’audience pour pouvoir vendre de l’affichage aux annonceurs. D’autres misent sur des partenariats directs avec des marques, sous forme de publi-rédactionnel, de native advertising voire même de prestations conseils. Le Télégramme a de son côté fait le choix d’un contenu exclusif, à forte valeur ajoutée, monétisé à travers les abonnements de ses lecteurs. Samuel Petit, rédacteur en chef du quotidien breton, nous explique dans cette interview comment la ligne éditoriale a évolué pour accompagner ce changement, et en quoi la mise en place d’un paywall a permis au journal de se recentrer sur ses fondamentaux.
Quelle a été votre réflexion au moment du passage en paywall du site letelegramme.fr en 2014 ?
Quand nous sommes passés à ce premier modèle de paywall, nous avons rendu payant l’ensemble de notre contenu à l’ensemble du public, en nous basant sur un crédit d’articles gratuits. Nous partions du principe que nous publions de l’information de qualité très spécifique, et qu’il fallait nous écarter de la course aux clics. Nous avons toujours eu une forte fidélité de notre lectorat, avec plus de 80% d’abonnés à notre version papier, qui sous-entend une relation forte et pérenne avec notre public. Cela avait donc du sens par rapport à notre ADN de dupliquer ce modèle auprès de nos consommateurs numériques. Faire financer l’information de qualité par le lecteur est d’ailleurs un mouvement de fond qui a agité la presse ces dernières années, et sur lequel nous avons eu un temps d’avance.
Mettre en place cette stratégie avec un temps d’avance est-il un avantage important face à la concurrence ?
Pour commencer, cela permet de maîtriser les technos, mais aussi de constituer un historique de données pour voir comment réagissent les internautes. Ensuite, la question de la nature éditoriale des contenus sur lesquels les lecteurs sont bloqués se pose. Nous avons beaucoup appris sur ce sujet. On ne peut pas bloquer un internaute de la même manière sur un contenu à faible valeur ajoutée issu d’une dépêche AFP ou d’un communiqué de presse, que sur un contenu qui a nécessité un temps d’enquête ou d’investigation très lourd. C’était l’inconvénient du paywall identique pour tous : le sixième article devenait indisponible pour tous les visiteurs, quelle que soit sa nature. Cela nous a poussé à privilégier la qualité de nos contenus, à diminuer la part d’articles disponibles ailleurs sous des formes très ressemblantes. Mettre en place un mur payant pour aller chercher les quelques sujets à fort potentiel de clic du jour n’aurait pas de sens, car ils ne génèreraient aucun abonnement. Cet acte fort ne peut venir que d’une plus-value, d’une valeur d’usage, d’une information exclusive.

Quels sont les types d’exclusivité que vous développez ?
Il y a plusieurs niveaux d’exclusivité. Le premier niveau, c’est l’information que personne d’autre n’a en sa possession. C’est l’essence du journalisme. Cela peut justifier un abonnement en soi, notamment pour de l’information locale ou régionale dont l’accès est conditionné à la lecture des articles en question. Ensuite, il y a l’exclusivité de traitement. On va apporter un regard particulier qui va correspondre à la cible que l’on vise. Le sujet n’est pas nouveau, mais l’angle avec lequel on va l’aborder ou la façon dont on va le raconter diffère. En ligne, le champ des possibles est très large sur cet aspect, puisqu’on peut utiliser de la photo, du texte, de la vidéo, de la data, de l’infographie animée…
Le fait d’avoir une audience très fidèle et des thèmes de prédilection où vous êtes référent doit aider sur cette notion d’exclusivité.
Nous avons effectivement une « exclusivité de proximité ». Les lecteurs et les internautes savent que sur tel ou tel territoire de la Bretagne, nous allons être les plus à même de les informer. A nous de produire l’information qui, à leurs yeux, justifie d’être abonné. Cette proximité est notre spécificité, centrée sur le local et le régional. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi de la valeur d’usage et de service. Il faut que ce contenu, au-delà de donner une information exclusive, permette à l’internaute de progresser ou d’avancer dans sa vie. Il faut qu’il représente un début de service. Par exemple, si on parle du stationnement à Brest, ça ne suffit pas de dire que les horodateurs ont changé. Il faut expliquer comment stationner ou se déplacer au mieux dans Brest. La notion d’utilité est très forte, c’est ce que nous développons actuellement.
Quel est l’objectif principal de l’adaptation de votre ligne éditoriale ? Fidéliser les lecteurs existants ou essayer d’en faire venir de nouveaux ?
L’enjeu est d’aller chercher de nouveaux lecteurs, comme Le Télégramme a toujours su le faire sur le papier. Nous avons réussi à attirer de nombreux lecteurs entre 25 et 35 ans lors des deux dernières décennies à travers un produit papier qui les séduisait. Pour faire de même avec la génération qui arrive, il faut leur parler de leur environnement proche d’une manière qui les interpelle. Nous développons donc la notion de promesse éditoriale : assurer que si on lit un article sur notre site, on va apprendre quelque chose, qu’il y aura une dimension pédagogique et un vrai effort de reportage et de préconisation. Cela se travaille lors de l’animation éditoriale, lorsqu’on élabore les sujets. Nous réfléchissons à ce qui va déclencher l’envie de lecture, ou de visionnage si c’est une vidéo. Nous travaillons nos angles et faisons émerger des modes rédactionnels différents. Il faut que notre promesse éditoriale soit solide, et surtout qu’elle soit tenue pour pouvoir attirer et fidéliser, en maintenant une forte valeur d’information et d’usage.
Le passage au paywall a donc été une manière de se remettre en question et de se recentrer sur les besoins des lecteurs.
Le paywall et le digital nous ramènent vers les fondamentaux du métier. Est-ce que je parle réellement au lecteur ? Est-ce que le sujet que je suis en train de traiter concerne directement le lecteur ? En quoi ce sujet a-t-il un impact sur la vie quotidienne du lecteur ? Parce que l’environnement dans lequel nous évoluons aujourd’hui, aussi bien planétaire que local, touche de près ou de loin un lecteur. Les décisions relatives à l’environnement ou à l’économie prises à l’autre bout de la planète ont un impact sur leur quotidien. C’est à nous de ramener le lecteur au centre de l’information que l’on produit. Cela reste un des fondamentaux du journalisme. Ce n’est pas le digital qui l’a amené, mais le digital nous le rappelle.
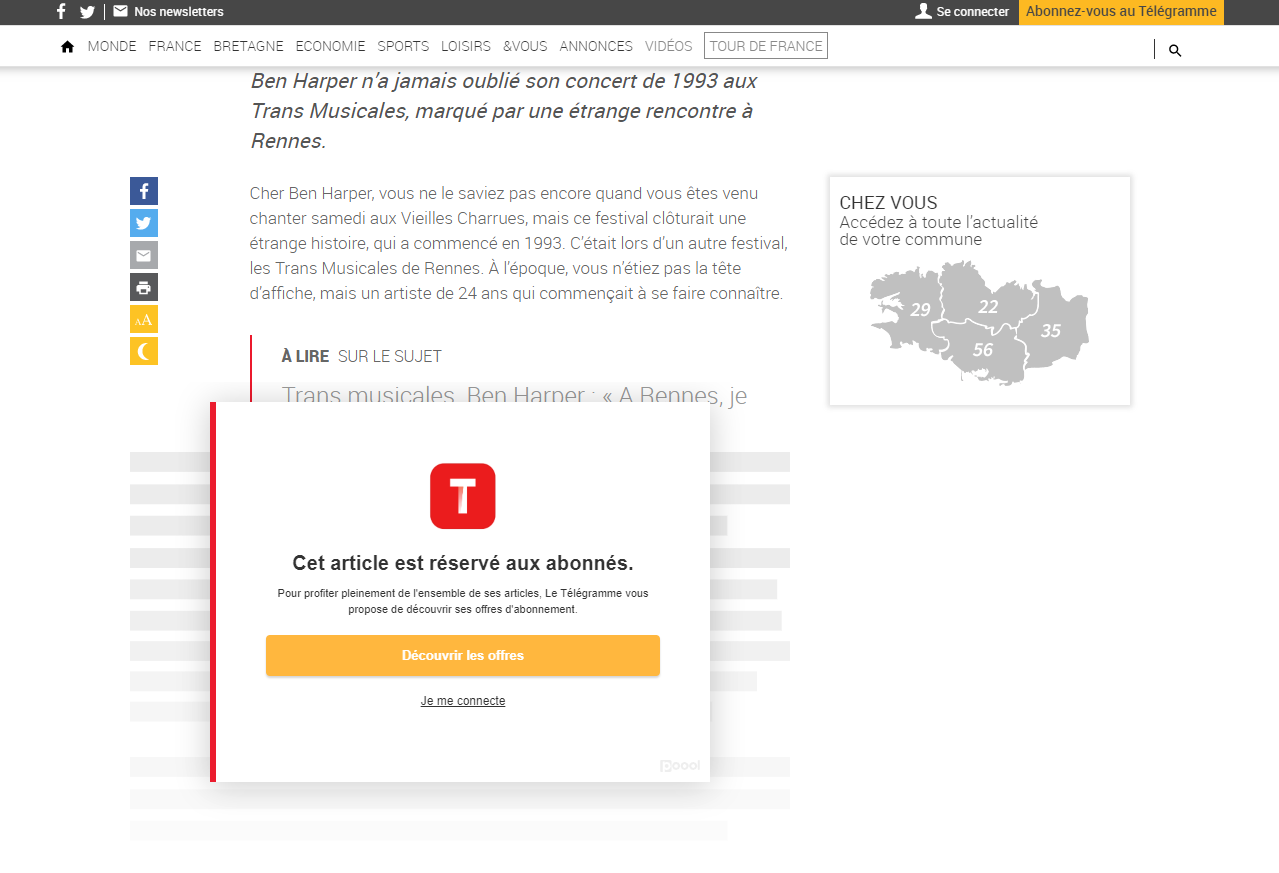
Le digital est-il un moyen plus efficace pour s’adresser aux jeunes, qui ont un rapport moins quotidien avec la PQR que leurs aînés ?
Un média comme le nôtre s’est toujours adressé aux jeunes Bretons quand ils rentrent dans la vie sociale et active. On commence à lire Le Télégramme de ses parents quand on est ado, puis on entretient une relation payante avec le journal quand on trouve un travail et que l’on s’installe de manière pérenne dans une ville ou une commune de Bretagne. Ce moment de rencontre reste globalement le même, c’est celui où quelqu’un se sent suffisamment partie prenante de l’environnement local pour qu’il ait le besoin de s’informer sur cet environnement. Le digital nous permet de nous adresser plus facilement à eux, avec de nombreux leviers, et une culture de l’abonnement qui prend de l’importance chez les jeunes. Ils s’abonnent à Netflix, à certains services de livraison à domicile, de transport ou encore de streaming musical. Des abonnements mensuels à prix modéré pour avoir de l’information de qualité se placent dans la continuité de cet élan.
Le passage récent à un smart paywall a-t-il fait évoluer la donne ?
L’intérêt du smart paywall est de plus ou moins ouvrir le paywall selon le profil de lecteur. On va donc ouvrir l’accès à des profils sur lesquels nous avons relativement peu d’espoir de conquête : quelqu’un qui n’habite pas en Bretagne, quelqu’un qui ne lit qu’un article toutes les semaines, quelqu’un qui vient systématiquement des réseaux sociaux, etc. A l’inverse, quelqu’un d’identifié comme ayant de l’appétence pour des sujets régionaux, de proximité, économiques ou sportifs va avoir des accès fermés à ce type de contenu qui représente une forte valeur ajoutée dans son usage. Nous allons pouvoir, grâce aux données, observer quels sont les sujets et la manière de les traiter qui améliorent la conversion numérique, et cela par type de public. Et donc alimenter notre rédaction avec des informations permettant de créer de la plus-value éditoriale.
Le passage au smart paywall pousse donc à continuer à privilégier la qualité à la quantité ?
Nous allons mettre en place une analyse des données non plus uniquement quantitative, comme Google nous y a habitués, mais surtout qualitative. Quelle est la réelle performance de mon contenu ? Que 50 000 personnes le lisent, dans l’absolu, n’est pas utile. Il est préférable qu’il y en ait 10 000 qui le lisent et 50 qui s’abonnent, que 50 000 qui le lisent et 3 qui s’abonnent. La rédaction va donc devoir accepter une forme de reporting un peu nouvelle, basée sur la qualité et l’engagement plus que sur la quantité et les pages vues.






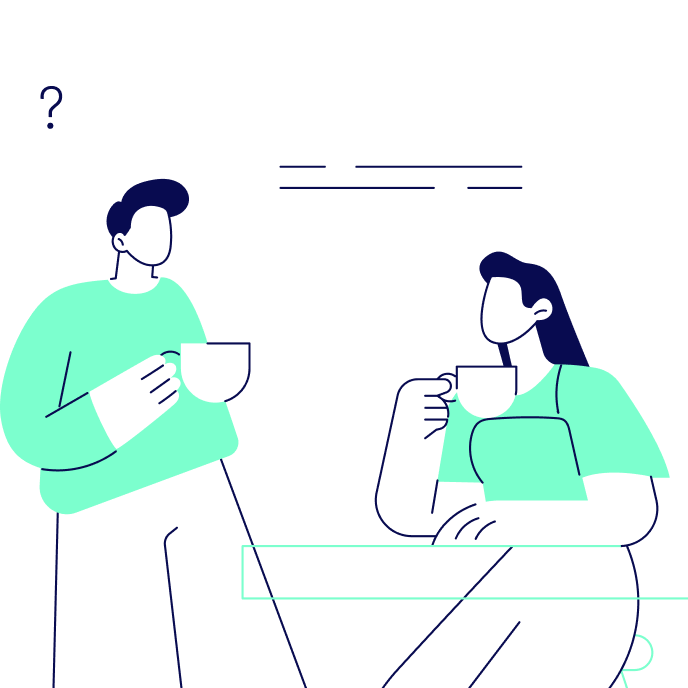
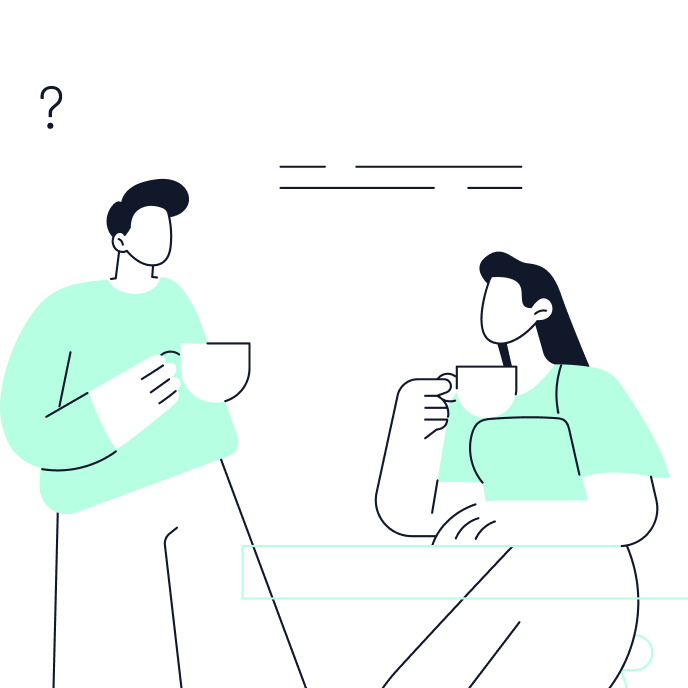


Bonsoir,,
En effet, si je comprends le raisonnement et l’approuve; cela ne pose-t-il pas un problème sur l’avenir même de la création de contenu sur la Toile ? Privilégier la qualité et l’engagement est-il viable sur le long terme ? La concurrence de nouveauxx acteurs ne risque-t-elle pas de remettre votre décision en cause ? …Merci en tout cas de la franchise …c’est en soi un point positif, et heureusement, que l’accès à cet article soit libre … encore une problématique à soulever ….