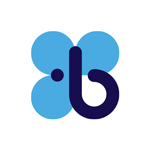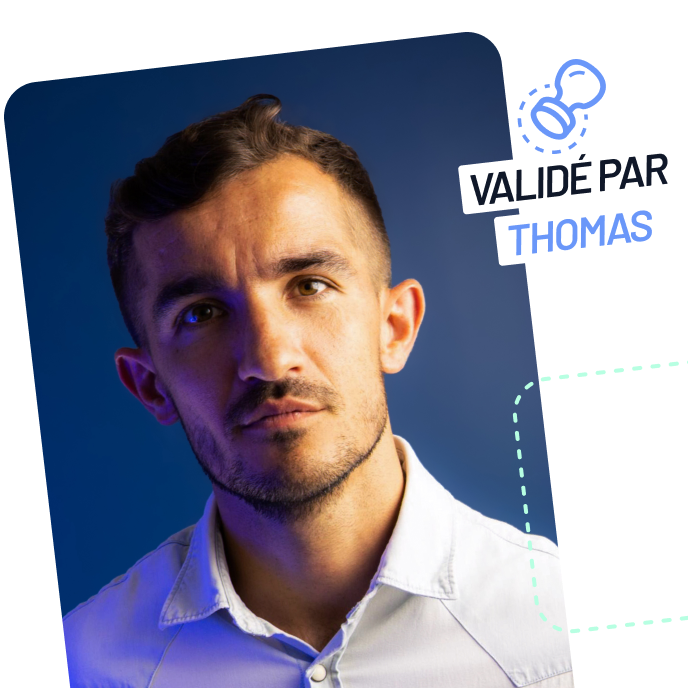Entreprises et numérique responsable : comment sortir du greenwashing ?
Frédéric Bordage, expert du numérique responsable, décrypte les vrais leviers pour aider les entreprises à réduire concrètement leur impact environnemental.

Présenté comme un levier d’innovation et de performance, le numérique est aussi devenu un puissant vecteur de pollution. Entre multiplication des écrans, stockage massif de données et essor de l’IA, son empreinte écologique explose. Pourtant, les entreprises peinent encore à en mesurer les effets réels.
Pour déchiffrer cette problématique, nous avons échangé avec Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr et figure majeure du numérique responsable en France. Celui qui ambitionne de « réconcilier les ‘technophobes décroissants’ et les ‘geeks de la start-up nation' » accompagne depuis plus de vingt ans les organisations dans la réduction de leur empreinte numérique. Tour d’horizon.
L’impact du numérique est « dix fois trop élevé »
En se basant sur des analyses de cycle de vie (voir plus bas), Frédéric Bordage estime que le numérique représente entre 40 et 60 % de notre budget annuel soutenable, c’est-à-dire la part des limites planétaires qui revient à chaque habitant de la Terre. Autrement dit, nos usages numériques dépassent déjà largement ce qui serait soutenable à l’échelle mondiale. « Concrètement, c’est dix fois trop élevé », affirme le spécialiste.
Une problématique d’autant plus préoccupante que l’impact est vraisemblablement sous-estimé.
Les principaux acteurs du numérique, comme les GAFAM et les nouveaux acteurs de l’IA, ne fournissent pas les informations nécessaires pour compléter les calculs. Il y a deux grands trous noirs : le cloud et l’intelligence artificielle. Sur ces deux périmètres, tout le monde parle, tout le monde lance des chiffres, mais personne ne sait réellement, nous explique Frédéric Bordage.
Les équipements, première source de pollution
Le principal vecteur de pollution numérique est, de très loin, la fabrication des terminaux : écrans, smartphones, ordinateurs portables… Elle représente environ 80 % des impacts. Pour les entreprises, la réflexion relative à la réduction de l’impact environnemental se doit donc de prendre en compte, en priorité, l’utilisation de ces appareils. Pour Frédéric Bordage, deux paramètres doivent entrer dans l’équation : « réduire au maximum le taux d’équipement et allonger la durée de vie des équipements ».
Il faut sensibiliser les utilisateurs, parce qu’un écran supplémentaire de 24 pouces sur un bureau ruine tous les efforts réalisés à l’échelle du système d’information. Les écrans sont ce qui pèse le plus lourd.
Parmi les pistes, l’expert en sobriété numérique recommande également le reconditionnement, aussi bien lors de l’achat d’un équipement qu’au moment de s’en séparer, ainsi que les pratiques d’écoconception, qui prolongent la durée de vie en allégeant la couche applicative. Mais les éditeurs de logiciels peuvent eux aussi constituer un frein à l’allongement de la durée de vie des appareils.
Il faudrait mettre la pression sur les éditeurs de logiciels pour qu’ils allongent la durée des supports techniques. On le voit actuellement avec Windows 10. Microsoft impose de migrer vers Windows 11, qui requiert par exemple une puce TPM non présente sur de nombreux matériels existants. Cela pousse les entreprises à renouveler leur parc, même quand elles voudraient conserver leurs équipements.
Les faux amis et gestes symboliques
À l’inverse, Frédéric Bordage relève qu’un certain nombre de bonnes pratiques individuelles, souvent recommandées, ont pour effet de brouiller le message et de masquer les véritables facteurs de pollution. « Il y a tous les sujets ‘tarte à la crème’, comme la suppression des mails, qui détournent des vrais enjeux. Je peux le démontrer formellement : supprimer des mails n’enlève pas d’impact, et parfois en ajoute. Idem pour les moteurs de recherche ‘écolos’ type Ecosia. Ce ne sont pas de vrais moteurs, ce sont des surcouches qui ajoutent des impacts », nous précise-t-il.
Autre exemple surestimé : le streaming, pourtant souvent considéré comme un facteur majeur de pollution. « En réalité, quand on fait une analyse de cycle de vie, on constate que sur une heure de Netflix dans votre salon, plus de 80 % des impacts viennent de la fabrication de la télévision et de son alimentation en électricité », illustre Frédéric Bordage.
Le vrai danger, c’est que ces petits gestes détournent l’attention des enjeux structurants : le taux d’équipement et la durée de vie des appareils. Pendant qu’on parle de suppression d’emails, on ne parle pas des durées de garantie légales, qui devraient être d’au moins 5 ans sur tous les équipements.
Entreprises : comment mesurer efficacement l’impact ?
Bilan carbone : la fausse bonne idée
Pour les entreprises, le bilan carbone est devenu un exercice courant. Il vise à quantifier les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs activités, directes (chauffage, déplacements, énergie) ou indirectes (achats, transport, usage des produits). En France, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, les acteurs publics de plus de 250 agents et les collectivités de plus de 50 000 habitants. Pour les autres, il reste facultatif mais de plus en plus pratiqué dans le cadre des politiques RSE.
Frédéric Bordage est très critique du bilan carbone comme outil de mesure, car celui-ci ne s’attaque qu’à la question des gaz à effet de serre, qui représentent seulement 11 % des impacts du numérique. « Si une entreprise se limite au bilan carbone de son système d’information, elle passe à côté de 89 % des impacts. C’est littéralement du greenwashing : on ne regarde que 11 % du problème alors qu’on pourrait analyser 100 % », nous explique-t-il. Le spécialiste concède toutefois que la plupart des structures agissent de bonne foi, sans mesurer réellement les limites de l’exercice.
Souvent, ce greenwashing est involontaire. Les entreprises veulent bien faire, mais leurs prestataires ne maîtrisent pas le sujet. Ils vendent du bilan carbone parce que c’est ce qu’ils savent faire, et entretiennent cette croyance. Mais ce n’est pas suffisant. On ne peut pas bâtir un plan d’action sérieux et opérationnel en se basant uniquement sur 11 % du problème.
L’analyse du cycle de vie : le seul indicateur pertinent
En alternative, Frédéric Bordage recommande d’opter pour l’analyse du cycle de vie (ACV), « la méthode standard internationale pour quantifier les impacts environnementaux du numérique à l’échelle mondiale, européenne, française, d’une entreprise ou d’un service numérique ». L’ACV repose sur une approche multicritères : elle évalue l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou service, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie.
Contrairement au bilan carbone, elle ne se limite pas aux gaz à effet de serre mais prend en compte 16 indicateurs, comme l’épuisement des ressources, la pollution de l’eau, la perte de biodiversité ou encore l’acidification des océans. Cette méthode, reconnue au niveau international et encadrée par la Commission européenne, permet ainsi d’obtenir une vision globale des impacts environnementaux et d’éviter les effets de transfert, c’est-à-dire la réduction d’un impact au détriment d’un autre.
La force de l’ACV multicritères, c’est qu’elle oblige à trouver des solutions systémiques. Si on ne regarde qu’un indicateur, on risque d’aggraver les autres impacts. Si on prend en compte les 16 indicateurs, on est obligé de trouver des solutions globales. Et souvent, cela conduit à la sobriété, ce qui dérange certains acteurs économiques.
Quid de l’intelligence artificielle ?
Pour Frédéric Bordage, l’intelligence artificielle n’est pas une menace en soi, mais son impact dépend entièrement de l’utilisation qu’on en fait. « Ce qui compte, ce sont les usages. Une technologie peut générer des impacts inutiles, mais elle peut aussi apporter des bénéfices pour l’humanité. Ce n’est pas à moi, en tant qu’expert GreenIT, de définir quels usages sont utiles ou ‘respectables’. C’est un débat sociétal et politique, au sens noble du terme », nous explique-t-il.
Pour le fondateur de GreenIT.fr, la question du modèle économique est centrale : « Une IA très spécifique, taillée pour un usage particulier, peut être peu consommatrice de ressources. Elle peut être frugale, éco-conçue. » Mais la trajectoire actuelle suit une direction opposée. Plutôt que de privilégier la sobriété, l’industrie s’engage dans une course à l’innovation et à la surenchère technologique.
Sur le terrain, les retours sont inquiétants : collectivités, départements, entreprises veulent mettre de l’IA partout, sans réfléchir aux conséquences. Au-delà de l’impact environnemental, il y a aussi des enjeux critiques : la perte d’autonomie des décideurs, qui s’appuient trop sur des outils dont ils ne maîtrisent ni le fonctionnement, ni les biais.
Numérique responsable : où en sont les entreprises ?
Chaque année, GreenIT.fr publie le Benchmark Green IT, qui dresse un état des lieux de la maturité des organisations sur ces questions.
Après dix ans de recul, le bilan est contrasté. « Le niveau de maturité des entreprises sur le Green IT reste faible. Certaines sont très avancées, mais la majorité reste encore focalisée sur des sujets secondaires comme la suppression des mails », déplore Frédéric Bordage. Malgré un allongement global de la durée d’utilisation des équipements, l’impact du numérique en entreprise est passé de 40 à 60 % en une décennie, en partie à cause de la multiplication des écrans.
Autre impact souvent ignoré : le fonctionnement des directions des systèmes d’information. « Jusqu’à 50 % des impacts du système d’information peuvent provenir de la DSI elle-même, c’est-à-dire les déplacements domicile-travail des collaborateurs et prestataires, les mètres carrés de bureaux qu’ils occupent, et le matériel utilisé. Cette part est rarement prise en compte dans les évaluations, alors qu’elle est essentielle », souligne l’expert.
Côté écoconception, la tendance n’est guère plus encourageante. Les premières années du Baromètre de l’écoconception digitale laissaient entrevoir des progrès, mais Frédéric Bordage constate aujourd’hui une stagnation, voire une régression, portée par un contexte politique et économique moins favorable.
Pour l’expert, la solution pourrait venir par la formation des professionnels eux-mêmes. À travers la certification Green IT et Numérique responsable, il mise sur la montée en compétence des collaborateurs pour impulser un changement durable. Une manière de contourner les postures cyniques adoptées par certaines entreprises.
L’histoire montre que les changements profonds viennent des individus. Quand on atteint une masse critique de collaborateurs formés et sensibilisés dans une organisation, ces pratiques finissent par s’intégrer à son ADN.

Frédéric Bordage, Expert en sobriété numérique, Green IT et numérique responsable
Frédéric Bordage est expert du numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr. Référence en France sur l’éco-conception et la sobriété numérique, il accompagne entreprises et institutions dans la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis