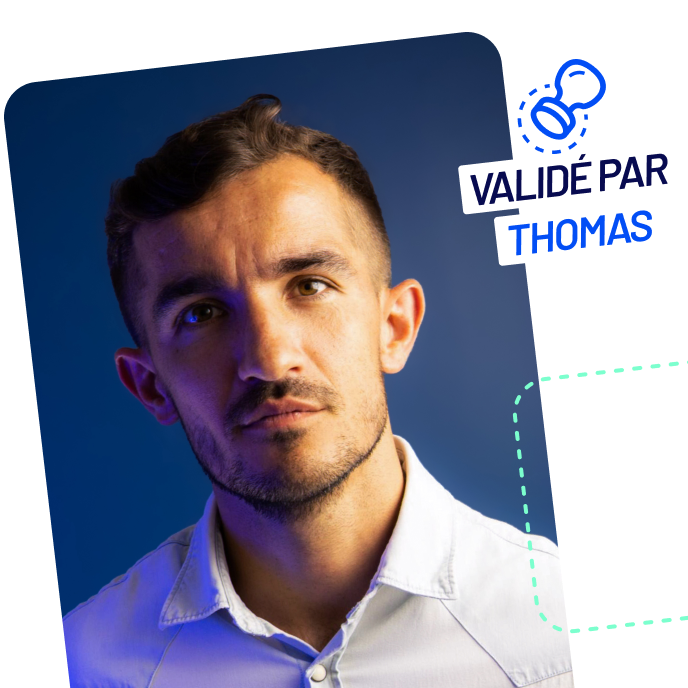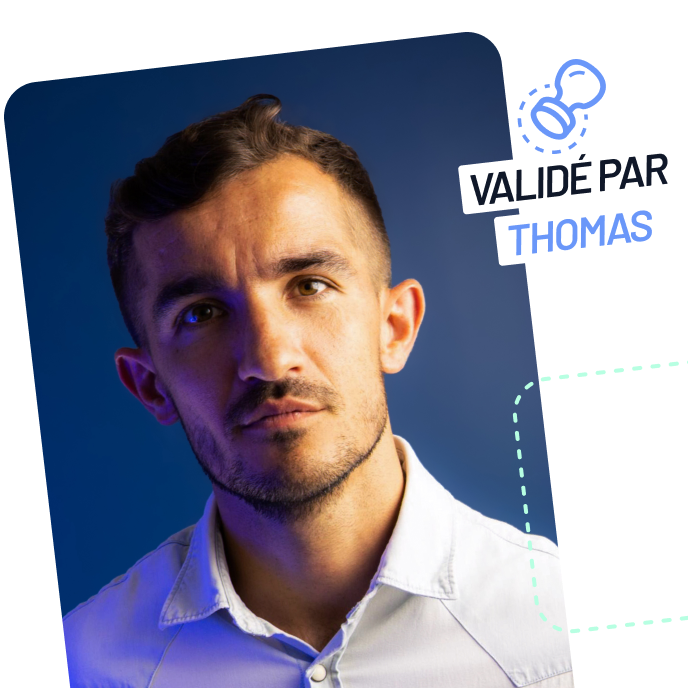De Diaspora* à Mastodon : l’utopie du réseau social décentralisé
Depuis l’avènement de Facebook, l’idée d’un réseau social alternatif où l’on conserve le contrôle de ses données a progressivement germé. Sans grand succès pour le moment.

Comme Ello, Yo ou Peach avant lui, Mastodon est devenu, un matin d’automne, le « réseau social qui monte ». Séduisant jusqu’alors une communauté restreinte mais croissante de technophiles, sans doute appâtée par l’interface visuellement proche de TweetDeck, ses « pouets » limités à 500 caractères ou son ambiance rappelant les origines de Twitter, Mastodon franchit un cap historique, le 7 novembre 2022. Ce jour-là, dans un post publié sur son compte, le fondateur Eugen Rochko annonce que le réseau social a dépassé la barre du million d’utilisateurs mensuels, à la suite de l’enregistrement de plus de 489 000 nouveaux utilisateurs en l’espace de quelques jours.
Pour afficher ce contenu issu des réseaux sociaux, vous devez accepter les cookies et traceurs publicitaires.
Ces cookies et traceurs permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d’intérêt.Plus d’infos.
Pour afficher ce contenu issu des réseaux sociaux, vous devez accepter les cookies et traceurs publicitaires.
Ces cookies et traceurs permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d’intérêt.Plus d’infos.
Une migration annoncée
Vous ne l’apprendrez sans doute pas ici, mais la migration vers cette plateforme fondée en 2016 était prévisible. Elle s’explique par l’officialisation, le 28 octobre, du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, après plusieurs mois de négociation. Pour échapper aux grandes manœuvres du PDG de Tesla et SpaceX, des milliers d’utilisateurs inquiets avaient, en réalité, progressivement quitté le navire à partir du mois d’avril.
Pour preuve : après l’annonce de l’accord de cession de Twitter pour une somme avoisinant 44 milliards de dollars, 80 000 déserteurs s’étaient, en l’espace de 24 heures, déjà mués en mastonautes pour dégainer leurs premiers pouets. Certains d’entre eux, convaincus de la mort imminente de la plateforme historique de microblogging, affichaient même un lien de redirection vers leur compte Mastodon dans leur description Twitter, avant que cela ne devienne définitivement interdit.
Another 43,292 users have arrived on various #Mastodon servers since that tweet!
— Mastodon (@Mastodon@mastodon.social) (@joinmastodon) April 27, 2022
Pour afficher ce contenu issu des réseaux sociaux, vous devez accepter les cookies et traceurs publicitaires.
Ces cookies et traceurs permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d’intérêt.Plus d’infos.
Une structure décentralisée et open source : l’atout charme de Mastodon
Sentant le vent tourner, Mastodon profite du momentum pour valoriser sa distinction fondamentale vis-à-vis de Twitter, dans un post qui est toujours épinglé sur son compte : une structure décentralisée et open source. L’objectif est limpide : fidéliser les nouveaux adeptes et convaincre les indécis, alors que Twitter traverse la période la plus incertaine de son histoire. « Cette structure décentralisée est ce qui rend Mastodon fondamentalement différent de Twitter et d’autres alternatives supposées, plaide le réseau social. Par définition, nous n’avons pas le pouvoir de définir vos règles, de vous montrer des publicités, de suivre vos données. »
Mais qu’est-ce qu’un réseau social décentralisé, au juste ? Pour faire simple, il se distingue par son architecture. En effet, il ne dispose pas de nœud central, mais d’une multitude de serveurs répartis dans le monde et qui coopèrent pour « former un réseau social mondial », comme l’explique la page d’entreprise de Mastodon. N’appartenant à aucune entité ou organisation, Mastodon est ce qu’on appelle un « réseau fédéré ». Chaque utilisateur peut, s’il le souhaite, héberger sa propre « instance » – un terme obscur qui désigne une sorte de mini-réseau social où l’on définit ses propres règles – tout en conservant la possibilité d’interagir avec des utilisateurs ayant opté pour d’autres noeuds du réseau, comme le détaille la page d’aide :
Depuis chaque instance de Mastodon, il est possible d’interagir avec les utilisateurs ou utilisatrices qui sont sur d’autres instances. C’est tout à fait comparable à ce qu’on peut échanger par courriel : vous pouvez envoyer un courriel depuis Gmail vers Yahoo, n’est-ce pas ? Cette possibilité d’échange existe aussi avec Mastodon parce que les instances sont connectées entre elles.
Après l’engouement, le retour à la réalité
Si l’architecture décentralisée, encore marginale à l’échelle des plateformes sociales, constitue un avantage concurrentiel pour Mastodon, elle ne lui a, du moins jusqu’ici, pas permis de renverser la table. En dépit d’une hausse de la fréquentation du site depuis octobre 2022, selon les données de Statista, Mastodon n’a que très peu bousculé Twitter, et l’a encore moins achevé avec ses 10 millions d’inscrits. À ce jour, la plateforme détenue par Elon Musk revendique, quant à elle, 564 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Peut-être est-ce, justement, à cause de son architecture complexe et déroutante, ou parce que la majorité des utilisateurs n’est pas encore prête à faire la bascule ? En réalité, qu’importe : Mastodon a rempli sa mission.
Car en étant rapidement catalogué comme le nouveau « Twitter Killer », Mastodon a mis en lumière un mode de fonctionnement alternatif et capable de s’imposer sur le long terme, bien qu’il soit complexe à mettre en oeuvre. Une structure plus égalitaire, respectueuse des données personnelles où le pouvoir décisionnel n’est pas exclusivement accordé à quelques puissants acteurs. Un vieux rêve de militant de l’Internet libre, en somme, mais qui ne s’était que très rarement matérialisé jusqu’ici à l’exception, peut-être, de Diaspora*. Ce réseau social ambitieux aspirait à ringardiser un autre pourfendeur des droits des internautes à l’aube des années 2010 : Facebook.
Diaspora* : l’autre tentative de réseau social décentralisé
S’il est risqué d’attribuer la paternité du concept de réseau social décentralisé à Diaspora*, cette plateforme éphémère en est, toutefois, l’une des premières incarnations. Le projet, lancé en 2010 par quatre étudiants de l’Université de New York, naît à la suite d’une conférence dispensée par le professeur de droit Eben Moglen.
Lors de cette intervention, dont la retranscription est toujours disponible en ligne, ce fervent défenseur du logiciel libre dépeint un monde où la vie privée sur Internet a disparu, où les utilisateurs acceptent, sciemment ou non, de céder gratuitement leurs données personnelles à de grandes entreprises centralisées comme Facebook. « Je ne dis pas que Facebook devrait être illégal. Mais il devrait être obsolète. Nous sommes des techniciens, nous pouvons réparer ça », alerte-t-il.
Inspirés par son monologue, les quatre étudiants imaginent alors un réseau social qui ne serait pas contrôlé par une entreprise mais par ses utilisateurs, avec une architecture semblable à ce que propose Mastodon aujourd’hui. En effet, Diaspora* ne dispose pas de « concentrateur central », comme expliqué sur le site, mais se divise en de multiples serveurs, hébergés par les utilisateurs et répartis aux quatre coins du globes. Baptisés pods, ces serveurs « contiennent les données des utilisateurs qui ont choisi de s’y enregistrer » et « communiquent entre eux naturellement » afin de faire « l’expérience d’un seul et même réseau ». Ce qui n’empêche pas Diaspora* de disposer des mêmes fonctionnalités qu’une plateforme classique. Ainsi, il est possible de partager du contenu, mentionner d’autres utilisateurs ou suivre des hashtags.
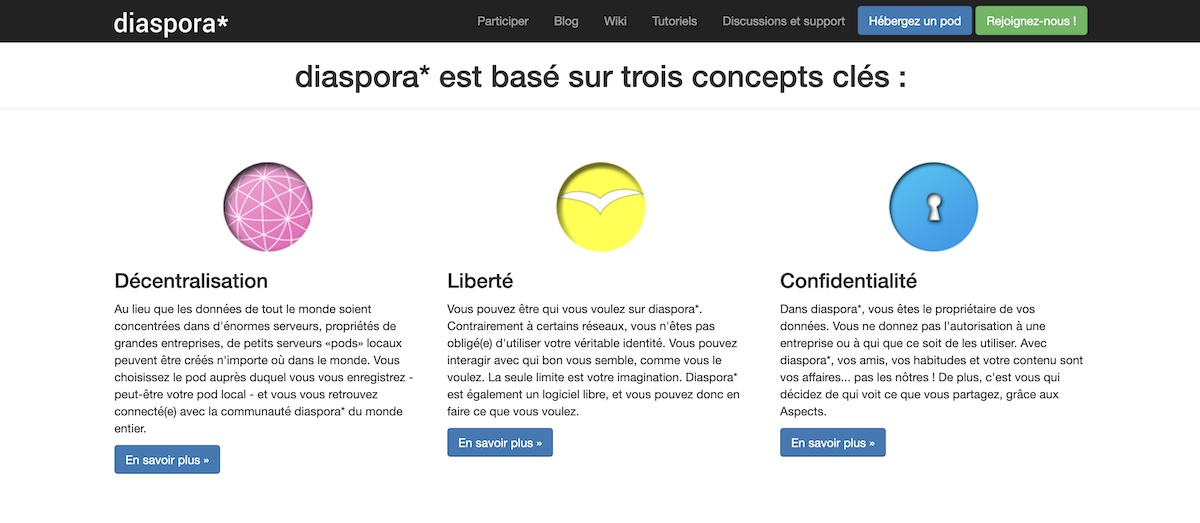
Le projet ficelé, les quatre étudiants bloquent leur été et lancent une cagnotte sur Kickstarter afin de récolter 10 000 dollars. Mais profitant d’une couverture dans le New York Times et d’un contexte de défiance grandissant vis-à-vis de Facebook, le projet Diaspora* récolte, finalement, plus de 200 000 dollars. « Toute cette attention nous a presque paralysés », reconnaît Maxwell Salzberg, l’un des initiateurs du projet, au New York Magazine. Parmi les milliers de donateurs, on retrouve même un certain Mark Zuckerberg.
L’échec du « Facebook Killer »
Ayant désormais une résonance internationale, Diaspora* est dépeint comme un « anti-Facebook » voire un « Facebook Killer » par de nombreux médias, alors que l’objectif de départ était, simplement, de prouver qu’une alternative était possible. « Qu’ils l’aient voulu ou non, ce qui était un moyen de passer leur premier été de jeunes diplômés venait de se transformer en une tâche titanesque, avec la pression et les attentes démesurées qui vont avec », confirme le journaliste Martin Untersinger dans les colonnes du Monde.
Résultat : le projet ne verra, finalement, que partiellement le jour. Après deux années de développement, une version fonctionnelle – mais pas définitive – de Diaspora* est mise en ligne, mais ne suscite pas de réel engouement. Puis ce qui devait arriver, arriva : en août 2012, les fondateurs annoncent, dans un communiqué, se retirer du projet et céder la plateforme aux utilisateurs. Dix ans après, Diaspora* est toujours accessible en ligne, et il est même possible de contribuer bénévolement à son évolution. Mais la plateforme n’a jamais réussi à bousculer Facebook, et encore moins l’achever.
La décentralisation : un modèle voué à l’échec ?
Si Mastodon et Diaspora* n’ont pas réussi à concurrencer les plateformes dominantes, il n’est pas dit que l’architecture décentralisée, bien qu’imparfaite, soit vouée à l’échec. L’engouement qu’a suscité ce modèle, à plusieurs années d’écart, prouve qu’il existe un intérêt pour des plateformes soucieuses des droits des internautes. Et c’est peut-être BlueSky, projet initié par Jack Dorsey et considéré comme l’alternative la plus crédible à X, qui pourrait en profiter.


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis