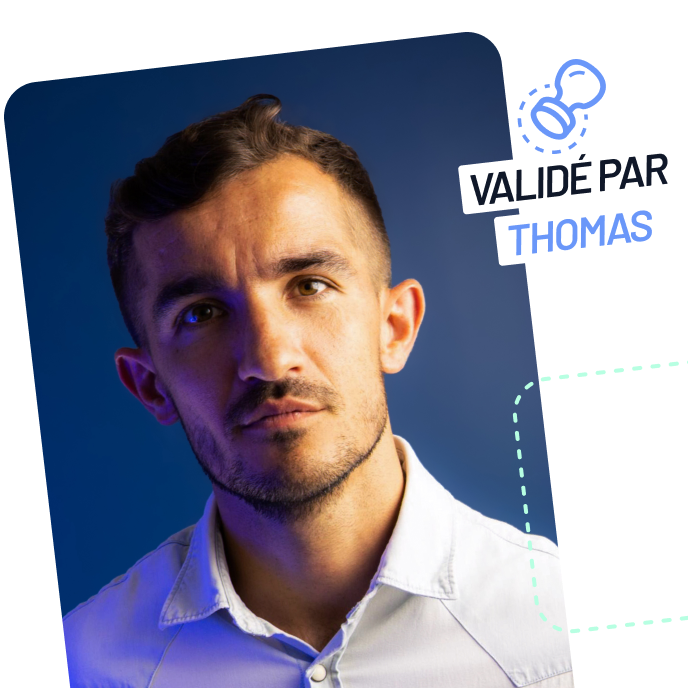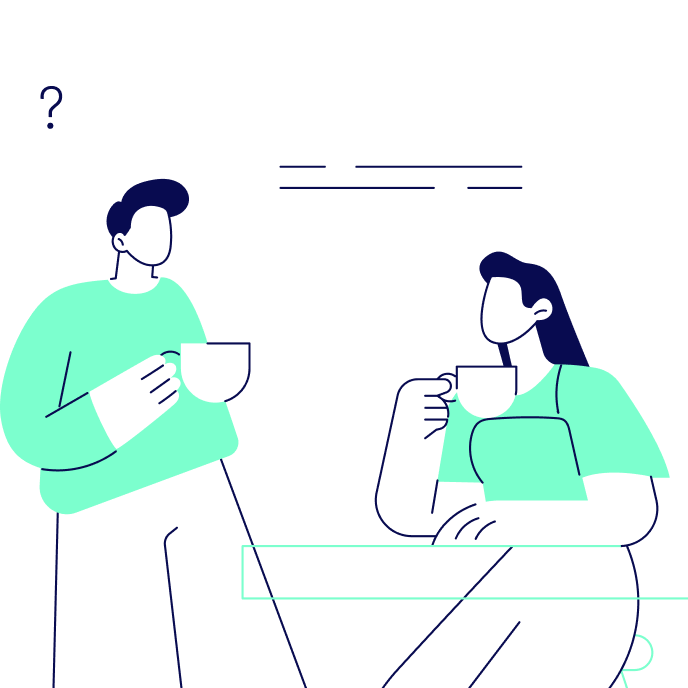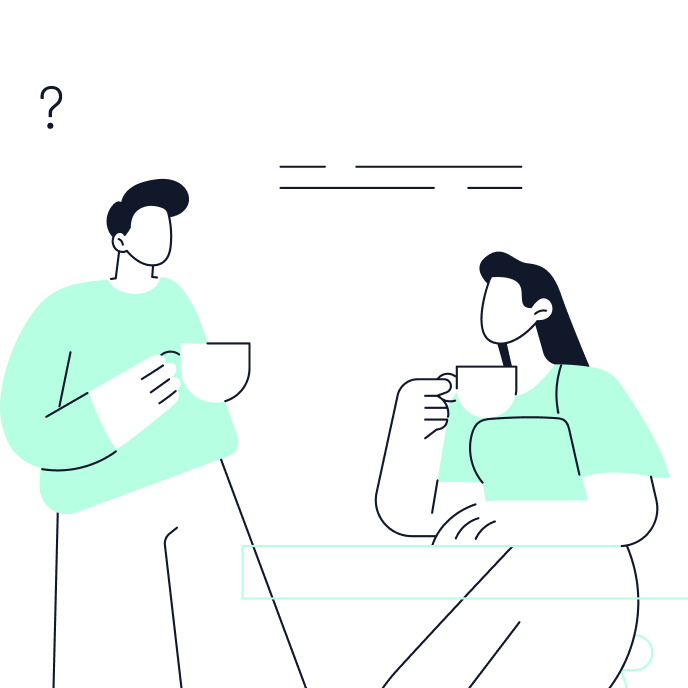Comment définir la notion d’éthique dans les métiers de la communication, du marketing et du web ?
Entretien avec Julien Pierre, enseignant-chercheur à Audencia Business School, sur la notion d’éthique appliquée aux métiers du numérique.

Communication et éthique sont deux sujets étroitement liés. Mais comment ? Pour le savoir, le mieux est encore de s’intéresser à la définition même de l’éthique, à ses différentes composantes, à ses différences avec la morale et à son application dans le monde professionnel, avec un regard particulièrement porté sur la communication, le marketing et le web. Julien Pierre, enseignant-chercheur à Audencia Business School, nous livre dans cette interview de nombreuses clés de compréhension pour mieux appréhender cette notion.
Comment définir la notion d’éthique dans le monde professionnel ?
Il y a souvent une confusion entre éthique et morale, à laquelle il faut faire attention. Il y a pourtant une grande différence. La morale implique que les mœurs sont propres à une époque (« autre temps, autres mœurs », dit le proverbe), et qu’elles ont donc une capacité à évoluer. Il y a des choses que l’on n’accepte pas moralement aujourd’hui, mais que l’on acceptait il y a 50 ans, et inversement. L’éthique est plus stable. Le serment d’Hippocrate, qui date du IV° siècle avant JC, n’a pas évolué depuis. La morale s’attache à définir ce qui est bien ou ce qui est mal à un moment donné, dans une période historique, alors que l’éthique va donner des conseils identiques depuis des siècles, qui vont permettre de guider son action en fonction de la morale du moment.
L’éthique se compose ensuite de différentes familles. Pour commencer, les philosophes distinguent l’éthique appliquée à un domaine professionnel de l’éthique normative. La première comprend par exemple le serment d’Hippocrate chez les médecins ou la déontologie des journalistes. La seconde est composée de trois familles d’éthiques que l’on peut essayer d’équilibrer dans sa vie de tous les jours, notamment au travail.
- Tout d’abord, il y a l’éthique des devoirs, l’autre nom de la déontologie, qui veut que l’on considère comme son devoir de faire les choses d’une certaine manière. On va mettre en œuvre des ressources et des actions pour accomplir ce devoir que l’on s’est fixé ou que quelqu’un nous a fixé.
- Ensuite, il y a l’éthique des conséquences, que l’on appelle aussi la téléologie. On s’intéresse ici aux finalités et à l’équilibre à trouver entre les moyens et les fins. L’action va être conduite (ou non) par rapport à l’anticipation de ses conséquences.
- Enfin, il y a l’étude des vertus, qui est un discours sur le caractère, sur la manière dont la conduite de ses actions va nous permettre de devenir vertueux, de s’épanouir.
Ces trois composantes permettent de structurer, organiser et consolider une démarche réflexive sur la conduite de son action professionnelle.
Comment s’appliquent ces différentes composantes de l’éthique dans le monde de la communication et du web ?
Ce qui est particulier dans le champ de la communication, c’est que les questions que se posent les professionnels sont à peu près les mêmes depuis une centaine d’années : est-ce que notre stratégie de communication a eu un effet ? Est-ce que l’on peut mesurer cet effet ? Est-ce que l’on peut dire qu’on a eu un impact sur les gens ? Qu’est-ce que cela veut dire, d’ailleurs, d’avoir un impact sur les gens ?
Les professionnels de la communication manipulent des leviers d’influence. Ils peuvent avoir un effet sur les gens, ce n’est pas anodin d’avoir à sa disposition un arsenal d’outils qui permettent d’influencer les comportements, les connaissances, les émotions, les opinions, les expériences que les gens vont vivre. Pour reprendre la sentence de Peter Parker, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Les communicants ont donc l’obligation d’avoir une réflexion éthique quand ils conduisent leurs actions. Une affiche pourrait choquer les gens. Est-ce qu’il ou elle peut s’autoriser à faire cette campagne de publicité ? Le déploiement d’un dispositif au sein d’une organisation peut modifier les rapports de pouvoir en mettant en visibilité certaines personnes au détriment d’autres. Est-ce qu’il ou elle peut se permettre de le faire ? Est-ce son devoir ? Est-ce qu’il ou elle peut penser les conséquences de son action ? Est-ce que déployer cette stratégie de communication va faire d’elle ou de lui quelqu’un d’épanoui ? On retrouve les trois questions de l’éthique normative dans ces réflexions.
Sur le numérique, on le voit bien avec la vague de fond de ce que l’on appelle la transformation digitale des organisations, qui comporte également une logique d’effet, d’influence. On va transformer l’organisation, la société, les rapports sociaux, etc. Donc là aussi, on ne peut pas se permettre, on ne devrait pas se permettre en tout cas, de piloter une transformation numérique dans une organisation, petite ou grande, sans avoir au préalable un questionnement éthique qui structure, qui guide l’action et la stratégie.

L’éthique professionnelle semble être un pré-requis dans le monde professionnel. Mais que se passe-t-il quand ce n’est pas le cas ? Est-ce un facteur d’employabilité ?
Tout le monde fait de l’éthique sans le savoir. Tout professionnel s’est posé, à un moment ou à un autre, des questions comme : est-ce que je signe ce contrat ? Est-ce que j’embauche cette personne ? Est-que je change mes prix, ma stratégie ? Est-ce que je sors ce produit ? Cela rejoint la notion d’éthique des conséquences. Et il y a bien sûr la déontologie qui est présente.
Pour prendre un exemple concret dans les métiers du numérique, on peut s’intéresser au cas d’un développeur web. Une fois que le logiciel qu’il codait est prêt, il va le donner clé en main à son client, à ses utilisateurs qui vont pouvoir s’en servir. La première conséquence est celle d’avoir quelque chose qui fonctionne. Ensuite, il peut se poser d’autres questions éthiques en termes de conséquences. Si le logiciel sur lequel il travaillait concerne la reconnaissance faciale, il n’aura peut-être pas envie que ses heures de travail servent au fichage de personnes dans des dictatures à l’autre bout du monde. L’autre aspect, du côté de la déontologie, est différent. Cela va par exemple concerner la manière d’envisager le travail bien fait, comme la documentation mise dans les fichiers source qui aidera les prochains développeurs à comprendre ce qui a été fait auparavant. Il peut considérer que c’est son devoir de documenter le code proprement et d’appliquer toutes les conventions qui existent pour que quelqu’un d’autre, arrive à le relire, le récupérer et le réexploiter.
L’éthique est un passage à la pratique, et c’est encore plus nécessaire au travail. Comment faire pour pratiquer son travail ? Quel cadre lui donner ? Quelles règles appliquer, qu’elles soient collectives ou individuelles ? Cela relève souvent de quelque chose d’invisible, qui s’est constitué au jour le jour par un ensemble de choix qui ont abouti à une liste de principes tacite. Il est donc difficile de valoriser son fonctionnement éthique dans une candidature, car ses contours seront flous et il est difficile de montrer des preuves ou des certifications de cette démarche. C’est encore balbutiant, même si cela apparaît de plus en plus.
Comment vérifier la bonne application de l’éthique, notamment en matière de recrutement ?
L’éthique est dans un entre-deux, entre quelque chose qui va définir son action propre et quelque chose qui se fera nécessairement en relation avec les autres. L’action individuelle est toujours projetée par rapport à quelqu’un d’autre. A partir du moment où on est dans une démarche éthique, on est forcément dans une démarche à destination d’un interlocuteur, d’un récepteur, de quelqu’un avec qui on va interagir. Et pour le recruteur, cela va être la démonstration que, en tant que professionnel, on a cette capacité à penser ses actions par rapport à l’environnement dans lequel on se situe, par rapport aux collaborateurs, à la hiérarchie, aux clients, aux prestataires, aux fournisseurs, etc.
La particularité de l’éthique appliquée, c’est qu’elle a été définie collectivement. On le voit notamment avec les ordres professionnels comme les médecins, les avocats ou les notaires. Ils vont vérifier que leurs membres conduisent bien leurs actions. C’est un débat qui a lieu actuellement avec les journalistes. Est-ce qu’ils doivent se doter d’un ordre ou est-ce que c’est uniquement leur éthique individuelle de journaliste qui prévaut et pour laquelle il n’y aurait pas besoin d’une organisation collective qui viendrait vérifier, sanctionner, accompagner, former, des journalistes à une éthique appliquée de leur métier, alors que ça existe dans d’autres professions ?
L’éthique appliquée va se retrouver dans un ensemble de normes sociales chez différentes corporations (développeurs, designers, marketeurs…). Des guidelines communes vont être mises en place pour définir les bonnes pratiques. Elles sont parfois écrites dans des livres blancs ou des manuels scolaires, peuvent être retrouvées dans des formations… Et le recruteur connait logiquement les conventions qui sont l’œuvre à l’intérieur de son organisation, et va chercher la mise en correspondance. Comment le candidat va-t-il pouvoir s’accorder avec les pratiques professionnelles de ceux qui sont déjà dans l’organisation ?
Qu’est-ce qui se passe quand les principes d’éthique du salarié ou du professionnel vont à l’encontre de ceux de sa boîte ?
L’individu qui se comporte d’une manière non conforme à l’éthique des autres va se retrouver sanctionné socialement avec, dans le pire des cas, un licenciement, ou au minimum une mauvaise réputation. Il sera celui qui fait mal son travail ou qui ne respecte pas ses collègues. Les fils conducteurs de chacun peuvent se retrouver en résonance ou en dissonance avec les principes des autres. Selon moi, le choc est moins important qu’avec la morale. On peut éthiquement faire son travail en se bornant à respecter le code déontologique, ou en s’intéressant qu’aux connaissances, ou qu’aux vertus qu’on pourraient en retirer. Comme chacun peut avoir des principes différents, des éthiques qui sont finalement très différentes les unes des autres, le choc est moins frontal que sur des questions morales qui sont posées socialement. C’est donc beaucoup plus difficile de sanctionner un comportement qui ne serait pas éthique, parce qu’il relève de quelque chose d’invisible. Ce sont des principes définis mentalement qui vont conduire une action. Ce que les gens verront, c’est l’action, et pas forcément les guides qu’il y a derrière cette action. On s’intéresse au résultat plus qu’à la manière de faire.


Évaluez BDM
Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !
Je donne mon avis