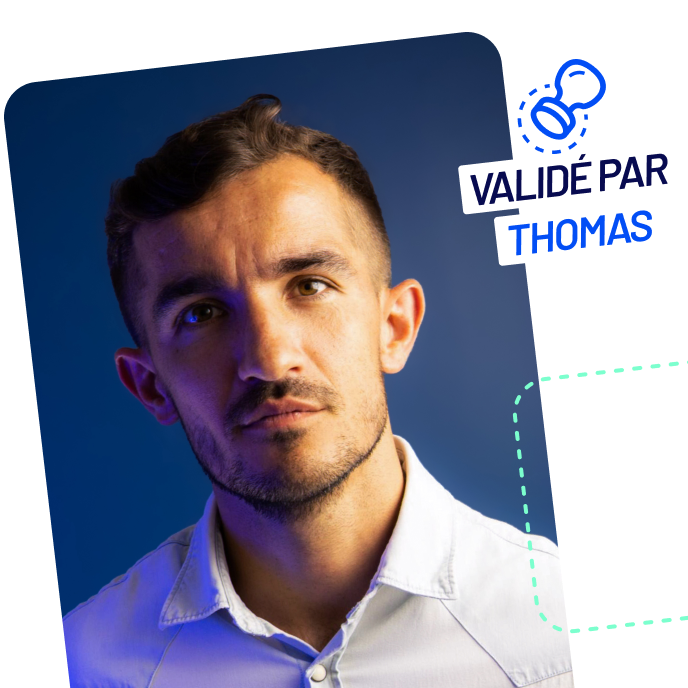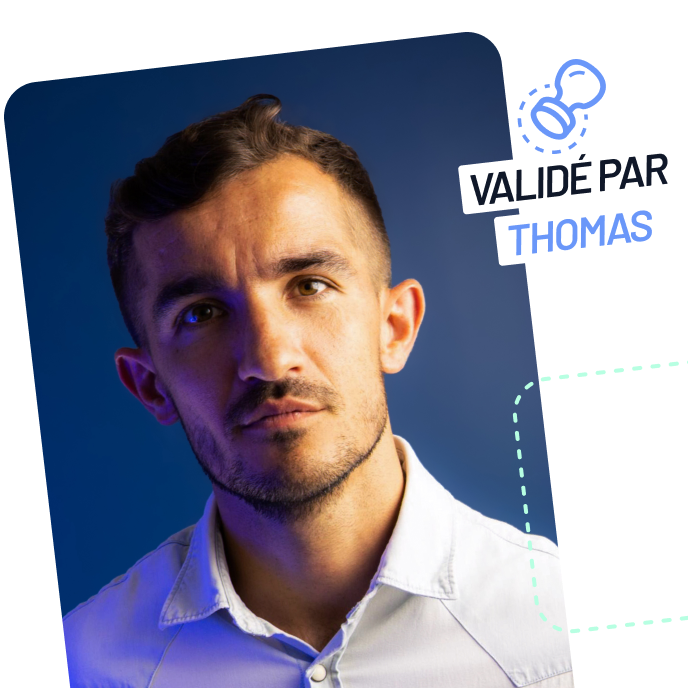Achats en ligne : quels sont les droits des consommateurs ?
Les entreprises du secteur du e-commerce sont tenues de respecter vos droits en tant que consommateurs. Quels sont-ils ?

Les plateformes du secteur du e-commerce doivent répondre à des exigences strictes pour instaurer la confiance et garantir des expériences fiables aux consommateurs. En France, un cadre réglementaire strict est en place pour assurer la sécurité des utilisateurs dans cet environnement numérique. Retour sur les droits qui encadrent les achats en ligne des consommateurs.
Le droit à l’information
L’article L221-5 du Code de la consommation indique que le professionnel est tenu de fournir au consommateur certaines informations « de manière lisible et compréhensible », préalablement à la conclusion de la vente. Les informations concernées incluent notamment (liste non exhaustive) :
- Les « caractéristiques essentielles du bien, du service ou du contenu »,
- Le prix et l’affichage de celui pratiqué avant l’application d’une réduction,
- La date à laquelle le professionnel s’engage à effectuer la livraison,
- Les informations relatives au vendeur (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, etc.).
À l’inverse, il est interdit d’intégrer des avis de consommateurs sans vérification préalable.
Le droit de rétractation
Le droit de rétractation est une possibilité légale offerte à un consommateur d’annuler un achat ou un contrat dans un délai déterminé, sans avoir à justifier sa décision. Il entraîne la résiliation du contrat de vente ou de fourniture de service. En France, la durée fixée pour exercer ce droit est de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (pour les contrats de prestation de services) ou de la réception du bien. En cas de retard dans le remboursement, l’entreprise s’expose à une majoration de la somme due.
À noter : pour certains biens, il n’est pas possible d’exercer le droit de rétractation. Cela concerne notamment les biens périssables (denrées alimentaires), les biens personnalisés, les journaux, ou encore les biens et services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier.
La garantie légale contre les vices cachés
La garantie légale contre les vices cachés s’applique aussi bien aux achats physiques qu’à ceux effectués en ligne. Le vice caché est défini comme suit par la Direction de l’information légale et administrative : « Un défaut (appelé vice) sur un bien ou un produit qui ne se révèle pas à la première impression. Ce défaut rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage que vous ne l’auriez pas acheté, ou l’auriez acheté à moindre prix, si vous en aviez eu connaissance. »
Pour pouvoir exercer ce droit, le défaut doit être non apparent au moment de l’achat et rendre le bien inutilisable ou en limiter considérablement l’usage. Le consommateur dispose de 2 ans à compter de la découverte du défaut pour faire valoir la garantie, dans la limite de 20 ans après l’achat.
Le droit à une livraison conforme
Comme mentionné précédemment, les conditions de livraison doivent être précisées avant l’achat de manière lisible et compréhensible. Le vendeur est tenu de livrer le bien à la date ou dans le délai convenu. En l’absence de précision, et sans accord préalable, le bien doit être livré sous 30 jours. De plus, le mode de livraison indiqué (à domicile, en point relais, etc.) doit être respecté.
Enfin, en cas de problème lié à la livraison (par exemple, si le produit est endommagé pendant le transport), le vendeur est responsable si la livraison est effectuée par le transporteur qu’il a lui-même proposé. En revanche, si vous avez choisi un transporteur, c’est ce dernier qui en porte la responsabilité.
La sécurisation des paiements
Depuis l’entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement (DSP2), la sécurisation des paiements en ligne a été renforcée grâce à l’authentification forte. Obligatoire pour les achats supérieurs à 30 euros, ce dispositif repose sur l’utilisation de deux des trois éléments suivants : un mot de passe ou un code, un appareil personnel tel qu’un smartphone, ou une donnée biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale, etc.).
Pour en faciliter l’adoption, les banques proposent des applications mobiles intégrant ce système. Des alternatives, comme les SMS ou les lecteurs de carte, restent disponibles pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas utiliser ces applications.
La protection contre les pratiques déloyales
« Est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Il s’agit par exemple de pratiques trompeuses et agressives », nous apprend l’article L. 121-1 du code de la consommation. Les pratiques commerciales considérées comme trompeuses sont listées ici.
Si vous pensez avoir été victime d’une pratique commerciale trompeuse, vous pouvez faire un signalement sur SignalConso, contacter le service RéponseConso ou vous adresser à l’une des 15 associations de consommateurs agréées.
La protection des données personnelles
Les commerçants en ligne sont tenus de respecter le RGPD pour garantir la sécurité des données personnelles des internautes. Cela inclut l’obligation d’informer clairement les utilisateurs sur l’utilisation des données collectées (identité du responsable, finalité, durée de conservation, droits des utilisateurs) et d’obtenir leur consentement explicite pour des actions telles que l’envoi de newsletters ou l’utilisation de cookies. Le consentement doit être donné par un acte positif clair, avec des options telles que « Tout accepter » ou « Tout refuser ».